Aux États-Unis, l'IA fait flamber les factures d'électricité
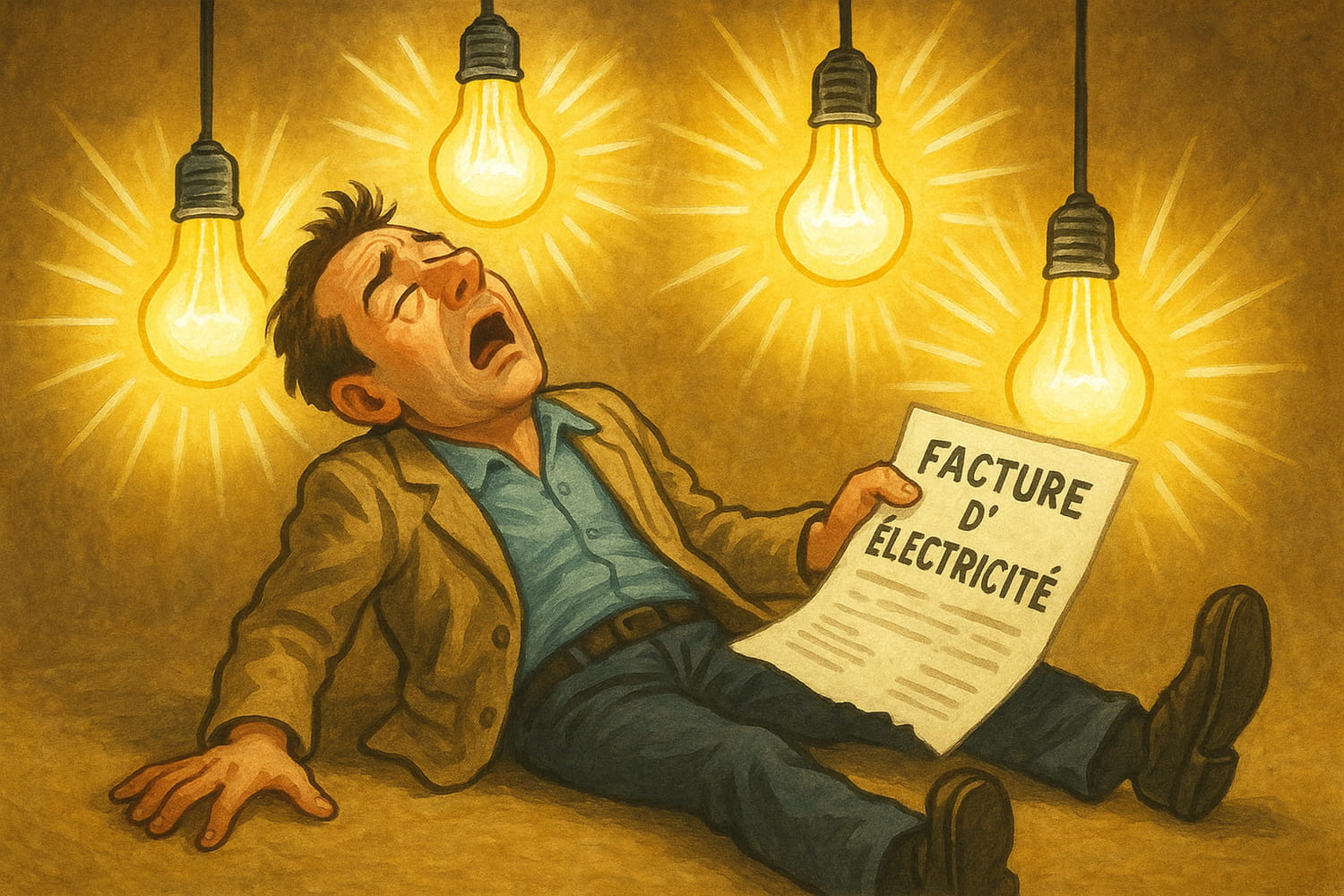
Le risque de voir sa facture d'électricité flamber à cause de l'insatiable voracité des centres de données où tournent les algorithmes d'IA est, pour de nombreux Américains, en passe de se concrétiser. Un récent rapport de PowerLines, un lobby militant pour une énergie bon marché, montre ainsi que plusieurs énergéticiens américains ont déposé des demandes pour collecter 29 milliards de dollars supplémentaires auprès des consommateurs au premier semestre, une hausse de 142% par rapport à la même période l'an passé.
Aux États-Unis, les énergéticiens doivent en effet obtenir l'accord des autorités au sein de leurs États respectifs avant d'augmenter leurs tarifs, un processus visant à protéger les consommateurs contre les hausses subites et abusives.
La hausse prévue est due, selon l'organisation à but non lucratif, au fait que les températures estivales ne cessent de grimper, mais aussi à la pression sur la demande exercée par les centres de données, qui poussent comme des champignons pour répondre à la demande insatiable en matière d'IA. Un récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie prévoit ainsi un doublement de la consommation d'électricité par les centres de données dans le monde d'ici 2030, pour atteindre 945 térawatt-heure, soit davantage que la consommation électrique du Japon aujourd'hui. L'IA sera le facteur principal de cette augmentation : la demande émanant des centres de données spécialisés dans l'IA devrait ainsi quadrupler d'ici 2030. De quoi faire peser une forte pression sur la grille énergétique : l'État du Texas aurait à lui seul besoin de trente réacteurs nucléaires supplémentaires pour satisfaire à la hausse de la demande prévue d'ici 2030…
Des recherches conduites par Goldman Sachs prévoient pour leur part que la consommation énergétique des centres de données va croître de 50% d'ici 2027, et de 165% d'ici la fin de la décennie par rapport à 2023.
Les big tech investissent massivement dans l'énergie
Cette réalité pousse les géants des nouvelles technologies à investir dans des projets énergétiques pour répondre aux besoins de leurs centres de données géants. Google a ainsi prévu d'investir 20 milliards de dollars dans le déploiement de plusieurs projets autour de l'énergie solaire, de l'éolien et des batteries électriques, afin de produire suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins de plusieurs centres de données dédiés à l'IA.
Pour la construction d'un centre de données géant dans le nord de la Louisiane, Meta s'est pour sa part engagé à générer l'équivalent de la future consommation de celui-ci en énergies propres, grâce à des investissements dans le verdissement de la grille locale.
Depuis le début de l'année, Microsoft a de son côté financé des fermes de panneaux solaires dans l'Illinois, le Michigan et le Missouri, afin d'alimenter ses centres de données d'IA. L'entreprise débauche également des talents issus de l'industrie nucléaire et étudie la construction de petits réacteurs modulaires près de ses centres de données pour répondre à leurs besoins. Elle a également signé un accord avec la jeune pousse Helion, qui ambitionne de construire un réacteur à fusion nucléaire, afin de lui acheter de l'énergie dès 2028.
Si ces investissements sont bienvenus, ils demeurent encore insuffisants : Goldman Sachs Research estime ainsi que 720 milliards de dollars supplémentaires seront nécessaires pour moderniser la grille énergétique américaine d'ici 2030, afin de répondre à la demande générée par l'IA. En Europe, la pression sur la demande sera moindre, mais malgré tout non négligeable : entre +10 et 15% sur les dix à quinze prochaines années, toujours selon Goldman Sachs.
Trump fait les choux gras de la Chine
La Big Beautiful Bill de Donald Trump est toutefois une mauvaise nouvelle pour ceux qui s'inquiètent de l'incapacité de la grille énergétique américaine à répondre à la demande d'IA. En effet, la première grosse loi budgétaire passée par l'administration Trump 2.0 supprime la plupart des crédits d'impôt dont bénéficiaient jusqu'à présent les projets autour du solaire et de l'éolien (seuls ceux qui seront mis en service d'ici 2027 pourront désormais en bénéficier), ce qui risque de considérablement freiner leur mise en œuvre.
"La Big Beautiful Bill va réduire l'investissement cumulé dans les énergies propres de 500 milliards de dollars entre 2025 et 2035", estime Jesse Jenkins, professeur à l'université de Princeton et spécialiste des questions énergétiques. "Elle va ainsi réduire de 820 térawatt-heures le volume d'électricité propre généré d'ici 2035, soit l'équivalent de la totalité du parc nucléaire ou du charbon américain aujourd'hui."
L'administration Trump entend compenser cette baisse par une hausse des énergies fossiles. La Big Beautiful Bill comprend en effet une batterie de mesures visant à faciliter la mise en œuvre de projets gaziers et pétroliers, en allégeant les contraintes environnementales pesant sur ces projets, réinstaurant certains crédits d'impôts supprimés pour favoriser les énergies propres et facilitant l'autorisation de projets sur les terres détenues par le gouvernement fédéral (qui représentent un peu moins d'un tiers du territoire américain). Cependant, si Washington peut faciliter le travail des géants du gaz et du pétrole en dérégulant et accélérant l'octroi de permis, il ne peut pas pour autant les forcer à forer.
"Ce qui pousse les entreprises à forer ou non dépend entièrement du ratio entre les coûts impliqués et le prix du pétrole, deux facteurs sur lesquels le gouvernement n'a aucun impact. La marge de manœuvre de Trump en la matière est donc assez limitée. Sachant que les États-Unis sont, en outre, déjà le premier producteur mondial", analyse Safak Yucel, professeur à la Georgetown University's McDonough School of Business, spécialisé dans les questions énergétiques.
En outre, même à supposer que l'administration Trump parvienne à accélérer la production d'énergie fossile, de tels projets nécessitent plus de temps que ceux autour du solaire, de l'éolien et des batteries. Une ferme solaire ou éolienne prend en moyenne moins de deux ans pour être opérationnelle, contre deux fois plus pour un projet de gaz naturel, et trois fois plus pour une mine de charbon. En 2024, 93% de la capacité énergétique ajoutée sur la grille énergétique américaine était ainsi due au solaire, à l'éolien et aux batteries. Or, la demande d'énergie supplémentaire générée par l'IA augmente rapidement, requérant des réponses tout aussi rapides.
De manière ironique, la loi passée par l'administration Trump pourrait profiter à l'avancée de… la Chine. En effet, celle-ci investit à toute vitesse dans les énergies propres, tout en construisant des centres de données d'IA à un rythme effréné, et ce malgré les sanctions américaines visant à freiner son avancée sur cette technologie. En dépit de la percée spectaculaire accomplie par DeepSeek en début d'année, l'Empire du Milieu demeure pour l'heure un cran derrière les États-Unis sur cette technologie de pointe. Mais l'administration Trump pourrait bien lui avoir par mégarde donné le coup de pouce dont elle avait besoin pour rattraper son retard.

